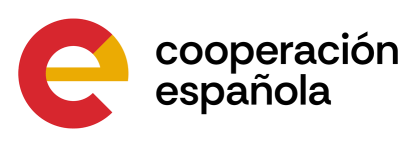Étancher sa soif en Haïti sans risque : pour un meilleure contrôle de la qualité de l’eau.
À l’occasion de la Journée mondiale du contrôle de la qualité de l’eau, la coopération espagnole met en avant les efforts de la DINEPA pour faciliter l’accès à l’eau potable en Haïti.

Population de Jacmel devant un point de distribution d'eau.
Le 18 septembre, on célèbre la Journée mondiale du contrôle de la qualité de l’eau, une opportunité de rappeler l’importance de garantir le droit humain à l’eau pour tous, en quantité et en qualité suffisantes. En Haïti, l’accès à l’eau potable reste un grand défi, car seulement 74 % de la population y ont un accès régulier à un point d’eau, et à peine 50 % ont cet accès à moins de 500 mètres de leur domicile. De plus, la qualité de cette ressource vitale est souvent compromise, avec un risque de contamination, exposant la population à de multiples risques pour la santé.
Les efforts de la DINEPA et de la coopération espagnole
Face à cette situation, la coopération espagnole continue de soutenir les capacités institutionnelles de la DINEPA pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement, en renforçant notamment la gestion, le contrôle et la distribution de l’eau dans les ménages.
Selon Guerda M. Elizé, responsable du service de contrôle et de la qualité, la DINEPA, en tant qu’organisme régulateur, doit « veiller à ce que l’eau ne soit responsable d’aucun mal-être chez le consommateur en aucun cas ».
Le mécanisme de surveillance de la désinfection de l’eau comporte deux étapes. Avant la distribution, le responsable (que ce soit du Centre Technique d’Exploitation -CET-, du Comité d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement -CAEPA-, ou d’un opérateur privé) effectue un test de résidu de chlore pour s’assurer qu’il respecte les critères de qualité. Si le test est satisfaisant, l’eau peut être distribuée ; sinon, la chloration doit être répétée. La deuxième étape a lieu au moment de la distribution, lorsque le responsable technique prélève des échantillons sur le terrain pour vérifier à nouveau le niveau de résidu de chlore. Les résultats sont recueillis et analysés par l’Unité de Contrôle de la Qualité de l’Eau. Ce suivi est réalisé chaque jour.
D’un point de vue du développement du secteur, il est intéressant de noter qu’Haïti ne produit pas de chlore et dépend de son importation pour son approvisionnement. Cependant, la production de chlore (ou électrolyse du sel) à l’échelle industrielle serait envisageable avec un investissement approprié dans les infrastructures, l’approvisionnement électrique et le sel.
Tant que la DINEPA (Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement) cherche les moyens de réaliser cet investissement, la qualité de l’eau demeure une préoccupation. Depuis janvier 2025, plus de 2 500 cas suspects de choléra ont été signalés à l’échelle nationale. La propagation est particulièrement intense dans les camps de déplacés internes, où l’accès à l’eau et aux installations sanitaires est souvent inadéquat.
La Journée mondiale du contrôle de la qualité de l’eau est aussi une occasion de rappeler que la gestion durable de cette ressource essentielle est une responsabilité partagée. La synergie entre la DINEPA, la société civile et les partenaires internationaux, dont l’AECID, est fondamentale pour améliorer les infrastructures, sensibiliser la population et garantir à tous un accès à une eau saine.
Outre l’action des institutions responsables, pour protéger leur santé, les familles haïtiennes peuvent adopter des gestes simples mais efficaces :
- Traiter l’eau avant de la consommer : utiliser des produits au chlore (comprimés), filtrer l’eau avec des filtres domestiques ou la faire bouillir pendant au moins une minute.
- Stocker l’eau dans un récipient propre, fermé et hors de portée des enfants, pour éviter toute contamination ultérieure.
- Vérifier la qualité de l’eau : si elle présente une odeur, une couleur ou un goût anormal, il est préférable de la traiter ou de s’abstenir de la consommer.
Chaque goutte compte. En adoptant de bonnes pratiques, nous pouvons réduire les risques de maladies liées à l’eau, contribuant ainsi au développement durable.